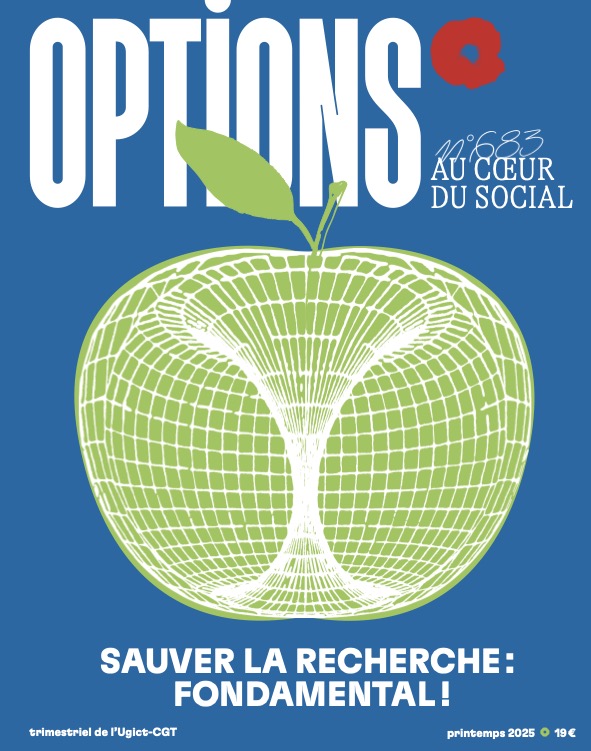“L’Écran rouge”, un ouvrage richement illustré d’archives photographiques souvent inédites, explore les liens occultés ou méconnus entre syndicalisme et cinéma, du Front populaire à la Nouvelle vague. Entretien avec l’historien qui a dirigé ce travail, Tangui Perron.
– Options. Avec L’Écran rouge, vous montrez que « le cadre favorable à l’émergence d’un des premiers cinéma du monde est le résultat de nombreux combats », pour reprendre une phrase de la préface de Costa-Gavras. Comment est né de projet ?
– Tangui Perron : Ce livre est un plaidoyer pour introduire l’histoire sociale et syndicale dans l’histoire du cinéma. Le projet est né il y a une vingtaine d’années, mais a connu une nouvelle impulsion voici un an, lors d’une rencontre réussie entre le Centre national du cinéma (Cnc) et la fédération Cgt du Spectacle à l’occasion de la 70e édition du festival de Cannes. En tant qu’historien, j’ai voulu me battre pour un sujet – les liens entre syndicalisme et cinéma – et le définir en rassemblant un arc de chercheurs confirmés ou plus jeunes, de différentes sensibilités. Costa-Gavras, président de la Cinémathèque française, en pose en effet clairement le cadre : il s’agit d’un travail qui plonge le lecteur dans « l’enfance méconnue du cinéma français » en mêlant imaginaire populaire, culture cinéphilique et histoire sociale. Il fait aussi une place aux militants et militantes qui ont nourri cette histoire collective : certains sont célèbres, d’autres beaucoup moins, souvent méconnus ou oubliés.
– Le rayonnement du cinéma français, nous montre ce livre, doit beaucoup aux combats menés depuis les années 1930 – avec notamment les grèves de 1936 et l’occupation des studios et laboratoires – jusqu’au seuil des années 1960. Quel rôle a joué le Front populaire dans cette histoire collective ?
– Au début des années 1930, avec l’arrivée de réfugiés venus d’Allemagne et d’Europe centrale dans le milieu cinématographique français, Charles Boriaud montre que se développe un syndicalisme corporatiste et xénophobe qui connaît, un temps, un certain succès. De même, dans une contribution éclairant les luttes sociales dans les studios français entre 1936 et 1939, Morgan Lefeuvre, enseignante-chercheuse en histoire du cinéma, met en évidence l’existence de courants antagonistes au sein du mouvement syndical avec, notamment, l’existence de syndicats patronaux très actifs. Sans l’effervescence politique et sociale du Font populaire et le volontarisme de certains, cette histoire aurait pu tout aussi bien basculer dans un monde plus sombre, une dystopie.
D’un certain point de vue, Jean Renoir illustre les fluctuations de la période : adhérent d’un syndicat ouvertement opposé à l’intégration des réfugiés venus d’Allemagne, il ne sera proche de la Cgt que très peu de temps. Il est toutefois impossible de réduire ce parcours à l’homme seul : il est aussi le produit d’un contexte économique, politique et social complexe, sous l’influence également de réseaux amicaux, professionnels et familiaux. Sa femme, la monteuse Marguerite Houllé, qui a aussi travaillé sur tous les grands films de Jacques Becker (Antoine et Antoinette, Casque d’or..), a ainsi joué un rôle important dans sa vie à la fois de cinéaste et de citoyen.
– « Le salut du cinéma est dans la Cgt », affirme Jean Renoir en 1937 dans un entretien à L’Avant-garde. Dans quel contexte prononce-t-il cette affirmation ?
– Les signes de très grande proximité qu’il émet à cette époque-là avec la Cgt et le Parti communiste sont nombreux. Ils sont d’autant plus spectaculaires que, quelques mois auparavant, il était sur des positions davantage corporatistes. Le cinéma français est alors en crise ; les deux principales entreprises françaises, Pathé et Gaumont, ont fait faillite. Il faut à tout prix réinventer un modèle économique du cinéma français, et ce modèle va à la fois s’appuyer sur un système artisanal et sur l’effervescence de la période.
Aux plus belles heures du Front populaire, la Cgt réunifiée, qui syndique non seulement les ouvriers du film mais aussi les techniciens et les réalisateurs, compte 4 millions d’adhérents. Elle est alors perçue comme un moyen d’assainir et de sauver le cinéma. Quatre millions d’adhérents, cela permet aussi de développer des projets.
N’oublions pas que Jean Renoir travaille alors à La Marseillaise, perçue comme le film du Front populaire réalisé par le cinéaste du Front populaire, à base syndicale et sur souscription populaire. Il porte aussi le rêve d’une nationalisation des moyens de production et de diffusion, comme en témoigne le générique avec une équipe ouvrière et technique entièrement Cgt, tout comme les figurants. Beaucoup était demandé à cette fiction et elle n’a pas forcément tenu toutes ses promesses : elle reflète l’espoir du Front populaire mais aussi sont relatif échec, lors de sa présentation sur les écrans français, début 1938.
– Justement, on connaît le combat syndical pour les conventions collectives, beaucoup moins le rôle de la Cgt comment productrice de films. Quelle dimension a pris cette action ?
– La Marseillaise est un arbre magnifique qui a parfois caché la forêt. En réalité, le désir de cinéma de la Cgt est très ancien. Il remonte à avant 1914, avec les premiers essais du Cinéma du peuple. Mais c’est en 1936 que tout change. Les artisans du film rejoignent la Cgt ; les acteurs et les metteurs en scène, qui étaient indépendants, font de même. La fédération du Spectacle comme alors à se définir et chaque fédération a davantage de moyens. La diminution du temps de travail et l’obtention des premiers congés payés mettent la question des loisirs et des pratiques culturelles au centre de la vie publique et réveillent le vieux rêve de cinéma social. La participation de la Cgt à des créations cinématographique prend alors la forme d’une trilogie fédérale, en 1938 : Sur les routes d’acier, Les Bâtisseurs et Les Métallos. Chacun veut avoir son film qui montre avec fierté les métiers, les conquêtes et les revendications syndicales. Ce ne sont pas des films forcément équilibrés ; ils ne sont pas toujours réussis. Mais chacun est passionnant à découvrir et la volonté est là. L’année 1938, c’est aussi celle où la fédération Cgt du Spectacle adopte sa forme définitive en absorbant le Syndicat général des travailleurs du film, après avoir déjà été rejointe par le syndicat des acteurs et par celui des techniciens du cinéma.
– Les relations entre syndicalisme et cinéma sont aussi marquées par deux temps forts : la « bataille » en 1947 et la mobilisation de 1948 pour sauver le cinéma français. En quoi ces deux moments traduisent-ils une continuité du combat syndical ?
– En 1939, le festival de Cannes n’a pas lieu. Le rêve de festival renaît en 1945, mais dans un contexte très différent : parce que les Américains peuvent alors importer leurs films depuis l’Italie, qui leur sert de tête pont, ils ne voient plus l’intérêt d’un festival cannois. Il faudra en réalité attendre 1946 pour qu’il s’ouvre et, heureux hasard, l’un des films primés est La Bataille du rail, de René Clément, produit par une coopérative ouvrière Cgt : on assiste alors à une sorte de renaissance du cinéma français sur des bases plus sociales et plus coopératives. Très vite pourtant, la situation se complique : la France est confrontée à d’immenses difficultés au sortir de la guerre et, pour les gouvernants, le cinéma n’est pas une priorité.
L’édition de 1947 n’aura lieu que grâce à l’implication des professionnels, du mouvement ouvrier, de la population cannoise et de ses élus. En réalité cette « bataille » de Cannes préfigure, un an plus tard, la mobilisation populaire et unanime des métiers du cinéma pour la défense du cinéma français, contre les accords Blum-Byrnes de 1946 et la menace de concurrence des films hollywoodiens. Cette lutte essentielle contribuera activement à la construction du modèle politique mis en place par les lois d’aide de 1948 et de 1953. Grâce à cette mobilisation, les professionnels du cinéma – acteurs, ouvriers du film, techniciens ou réalisateurs – deviennent des interlocuteurs légitimes de l’État.
– Une photo « totem » illustre d’ailleurs la couverture du livre : elle réunit sous une même pancarte, le 4 janvier 1948, deux légendes du moment, Jean Marais et Madeleine Sologne, ainsi que deux acteurs émergents, Claire Mafféi et Roger Pigaut, à l’affiche, un an plus tôt, d’Antoine et Antoinette. Quel rôle ont joué les acteurs ?
– Les grandes vedettes de l’époque sont des membres du bureau V – pour Vedettes – du syndicat Cgt des acteurs, un bureau créé sur une idée de l’acteur Fernand Gravey. Ils peuvent agir comme porte-drapeaux de la lutte, porteurs des revendications des ouvriers et des techniciens sur les plateaux ; certains apportent même leur cachet comme Gérard Philippe, proche du Parti communiste, un acteur réellement engagé et militant, parfois avec une main de fer. Il sera l’auteur d’un très beau texte, « Les acteurs ne sont pas des chiens », dans un éditorial publié en octobre 1957.
Ce bureau V est un outil de la fédération du Spectacle pour populariser les mobilisations tout en ayant, dans le même temps, ses propres spécificités et revendications. Tous les grands noms du cinéma français et du théâtre en ont fait partie : Bourvil et Fernandel de manière fugace, Simone Signoret, Bernard Blier qui avait une vraie fibre syndicale, Jean Gabin qui, lorsqu’il était au bureau V, était très proche de la base ouvrière et technicienne. S’il ne vient pas sur des bases politiques, Jean-Paul Belmondo, qui a incarné un rôle d’ouvrier dans Les Copains du dimanche (1956) sera de son côté président du syndicat des acteurs pendant trois ans, par générosité et volonté de défendre les acteurs, largement épaulé par Michel Piccoli. Il fera la Une de La Vie ouvrière en 1964. Le bureau V prend une importance particulière au moment de la lutte contre les accords Blum-Byrnes : en 1948, il lui est ainsi demandé de mettre en avant ses vedettes dans les mobilisations, ce qui produit un écho considérable notamment auprès des spectateurs. Mais il va progressivement s’étioler au cours des années 1950.
– Quelle a été la part des femmes dans cette histoire sociale et syndicale du cinéma ?
– Cette part, importante, est rarement évoquée. Certains s’imposent d’emblée, comme Simone Signoret, qui a été très active au sein des comités de défense du cinéma français et a participé à la vie des ciné-clubs : nous lui consacrons un portrait. D’autres ont été oubliées, comme Marguerite Houllé : nous avons voulu réhabiliter la part artistique et politique de cette grande monteuse. Que sait-on en outre des femmes cinéphiles qui ont contribué à la naissance de la Cinémathèque française, en septembre 1936 ?
Il faut se méfier des légendes cinéphiliques et de la notoriété concentrée sur quelques personnalités, au détriment des mobilisations collectives et de phénomènes plus complexes qu’il n’y paraît. C’est ce que nous montre Christophe Gauthier, professeur à l’École nationale des chartes, dans sa contribution : ce n’est pas un hasard si la Cinémathèque française est née en 1936, en bénéficiant de l’effervescence de ces années ; cette naissance bénéficie en outre d’une cinéphilie féminine, de ciné-clubs de femmes qui étaient très attachées à l’idée de transmission du patrimoine. Or cette histoire-là a, aussi, été complètement occultée.
Propos recueillis pas Christine Labbe
- Tangui Perron (dir.), L’Écran rouge. Syndicalisme et cinéma, de Gabin à Belmondo, préface de Costa-Gavras, L’Atelier, 2018.