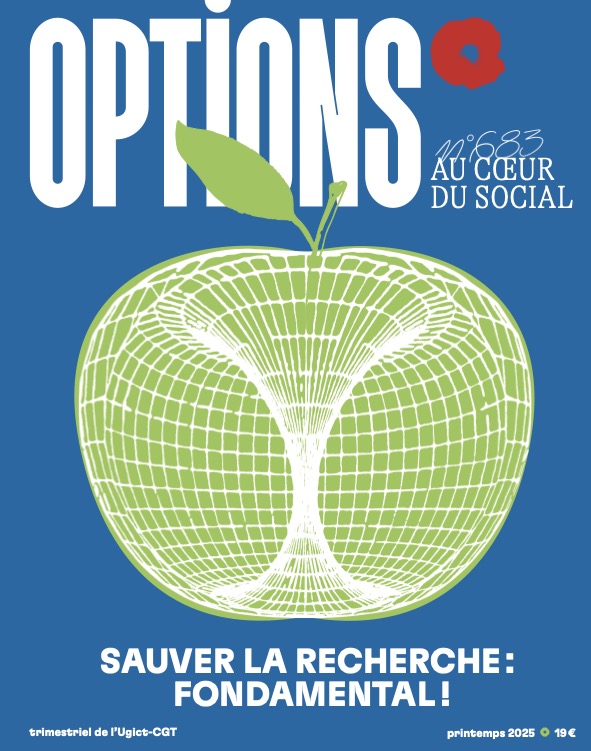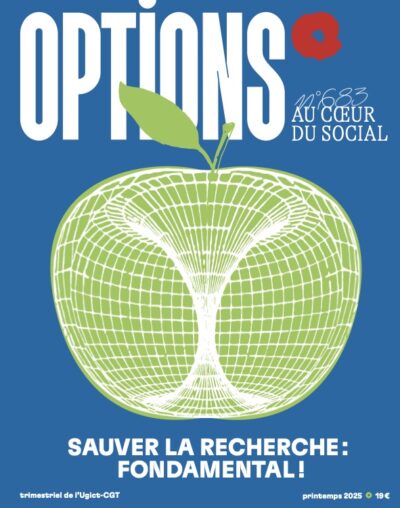Science et progrès, un lien toujours évident aujourd’hui ?
Un monde sans recherche est un monde sans avenir. Les défis actuels devraient à eux seuls justifier un effort redoublé : crise climatique, crise démocratique, échec du capitalisme, pauvreté, guerres… Il y a des réponses politiques à ces questions, mais aussi des réponses scientifiques, qu’il nous faut construire ensemble. Les enjeux sont internationaux et devraient logiquement pousser à davantage de coopération entre les pays et à davantage de science ouverte, à l’opposé de la logique de compétition géopolitique qu’on voit aujourd’hui se mettre en place. Il y a 2,4 millions de chercheurs en Chine, 1,5 million aux États-Unis et 2 millions dans l’Union européenne à 27. Faisons-les travailler ensemble à des réponses tournées vers le progrès humain plutôt qu’à la militarisation effrénée à laquelle nous assistons avec l’explosion des budgets militaires.« Il importe de réaffirmer une ligne nette entre la connaissance et l’opinion, entre les faits et les avis. Pour faire en sorte que les décisions qui engagent la société se prennent sur des bases où la rationalité et l’objectivité restent centrales. »Ces dernières années, la montée populiste a fait tomber la science de son piédestal, bousculée par l’avalanche des vérités « alternatives » et par une dévalorisation systématique de la démonstration scientifique, ravalée au rang d’opinion parmi d’autres. Les experts autoproclamés qui hantent les plateaux de télévision invoquent souvent fallacieusement la science et troublent les repères. Ils assoient surtout un rapport de domination qui vise à inculquer à la population ce qu’elle doit penser et croire. Cette forme d’emprise idéologique est l’inverse d’une science émancipatrice. Dans ce contexte, il importe de réaffirmer une ligne nette entre la connaissance et l’opinion, entre les faits et les avis. Pour faire en sorte que les décisions qui engagent la société se prennent sur des bases où la rationalité et l’objectivité restent centrales.
Défendre la liberté académique
La crédibilité et la confiance supposent la liberté académique. Or le constat est que les chercheurs sont de plus en plus soumis à des pressions. D’après l’Academic Freedom Index, la moitié de la population mondiale vivait dans une zone de liberté académique en 2006. Cette part est tombée à un tiers en 2024. Les risques de censure ou d’autocensure se multiplient sur certains sujets de recherche. Et dans le pire des cas, cela peut conduire à des falsifications. Cette évolution est inquiétante, car une science sous influence est une science qui perd sa crédibilité. Les capitalistes profitent aussi de cela pour contrer des conclusions scientifiques dérangeantes. Les lobbies cherchent en permanence à tordre la science pour servir leurs intérêts, au détriment de la population. Le scandale de la pollution par les Pfas en est un triste exemple. Mais on peut restaurer la confiance en répondant mieux à l’aspiration de contrôle démocratique des orientations stratégiques de la recherche. D’après le rapport annuel sur l’état de la France en 2024, 83 % des Français jugent sévèrement l’État pour sa passivité et son manque de vision stratégique dans le domaine de la recherche. On peut penser que s’il y avait une meilleure appropriation démocratique des enjeux de recherche et d’industrie, le démantèlement d’Atos, fleuron français, n’aurait pas pu se produire.Comment faire, y compris sur les lieux de travail ?
On peut, par exemple, redonner une légitimité et un réel pouvoir d’action à certaines instances trop peu écoutées. Le Conseil économique, social et environnemental (Cese), troisième chambre de la République, est un lieu d’échanges et de débats qui permet une réflexion approfondie sur de nombreux sujets, dont la recherche. Ses prérogatives pourraient être musclées pour agir davantage. Idem pour les Ceser, déclinaisons régionales du Cese, qui pourraient jouer un rôle contre les déserts scientifiques et universitaires. Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser), qui n’est vu que comme une étape administrative obligée pour des gouvernements qui passent tout en force, pourrait enfin devenir un lieu où les chercheurs influent sur les politiques de recherche et d’enseignement supérieur. Les orientations de recherche doivent aussi pouvoir se décider au plus proche du terrain. Il faut penser un renforcement global des contre-pouvoirs et un renouveau de la démocratie sociale. La « gouvernance » actuelle est à l’opposé des besoins de la démarche scientifique. La logique capitaliste, qui veut que tout soit géré comme une entreprise, s’est imposée comme mode de gestion du secteur de la recherche, permettant d’imposer l’austérité à tous les étages. Les travailleurs ont été dépossédés des choix stratégiques. Leur expertise est pourtant essentielle et doit être reconnue. Quand on le fait, ça marche, y compris dans le privé. Lorsqu’on associe les salariés de Thales aux choix stratégiques, ils ont tout de suite des idées et bâtissent des projets alternatifs, comme la reconversion d’activités de défense vers l’imagerie médicale. Depuis l’adoption de la stratégie dite de Lisbonne, en 2000, les pays de l’Union européenne se sont engagés à consacrer 3 % de leur Pib à la recherche (1 % pour le public et 2 % pour le privé). Ce chiffre n’a jamais été atteint par la France, qui se situait à 2,18 % en 2022. Il est sous la moyenne (2,72 %) des pays de l’Ocde.Sous-financer la recherche c’est fragiliser l’économie
La France décroche. Elle ne représente plus que 3,4 % des demandes de brevets en 2021 contre 4 % en 2010. Les effectifs de chercheurs sont insuffisants. Avec 11 chercheurs pour 1 000 actifs, le pays est au 10e rang mondial. Refuser de dépenser dans la recherche est aussi un très mauvais calcul… économique. Par exemple, l’industrie représente 80 % des exportations françaises, mais la filière ne pèse plus que 10 % du Pib (contre 20 % en Allemagne). Or les deux tiers des dépenses de R&D dans le privé sont orientées vers la filière industrielle. Il faudrait renforcer les investissements comme cela a été rappelé par la Cgt lors des états généraux de l’industrie et de l’environnement, en mai 2024. Le crédit impôt recherche (Cir) représente aujourd’hui 7,5 milliards d’euros, près de 20 % de l’effort d’investissement du privé, qui n’en a pas besoin. Rapportons cela aux 98,2 milliards d’euros de dividendes des entreprises du Cac 40 en 2025. Le Cir est un dispositif de générosité fiscale inefficace qui organise un transfert de financement du public vers le privé. Cette situation est d’autant plus scandaleuse que ce sont les 50 plus grosses entreprises françaises qui ont capté plus de 50 % des sommes versées au titre du Cir. Prenons un exemple concret. Michelin, qui a enregistré un bénéfice net de 2 milliards d’euros en 2023 tout en supprimant ses usines de Cholet et Vannes, a touché 42 millions d’euros au titre du Cir. Le Cir est donc à réinterroger, comme tant d’autres aides publiques versées sans conditions aux entreprises.L’appauvrissement de l’enseignement supérieur pèse sur l’attractivité de la recherche
Le manque d’attractivité des métiers de la recherche est patent, d’autant que le taux d’encadrement par étudiant a baissé de 17 % depuis 2010. On ne compte plus que 3,2 enseignants titulaires pour 100 étudiants. Près de 25 % des heures d’enseignement sont aujourd’hui assurées par des vacataires (l’heure de cours d’un vacataire revient à 50 euros là où le titulaire « coûte » 300 euros de l’heure). La dépense moyenne par étudiant dans l’enseignement supérieur est passée de 13 370 euros par an en 2010 à 12 250 euros par an en 2022. Cette austérité fragilise le public et laisse la place à des formations privées, qui représentaient environ 12 % des formations en 2000 et 25 % aujourd’hui. Ce mouvement ne fera que s’accentuer, le privé représentant désormais 40 % des offres de formation sur Parcoursup. Cette situation a également un impact sur la formation des docteurs. S’engager dans un doctorat, c’est désormais l’assurance d’une vie précaire. Alors que l’insertion postdoc pouvait se faire dans un délai de deux ans, la norme tend vers une précarité de cinq à six ans avant un emploi stable. À la rentrée 2022, on ne comptait plus que 70 700 doctorants, soit une baisse de 10 % depuis 2011. Certaines disciplines sont particulièrement sinistrées comme les sciences humaines, qui ont perdu un tiers de leurs doctorants. Parmi les docteurs formés en Europe, 20 % partaient aux États-Unis avant l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.Que propose la Cgt ?
La recherche doit être considérée comme un bien commun pour la société, c’est un enjeu essentiel d’avenir et d’intérêt général. Cela suppose que les chercheurs et personnels associés participent pleinement aux orientations de leur domaine d’activité, qu’ils aient les moyens de peser sur les choix stratégiques sur leur lieu de travail. La recherche doit devenir un enjeu citoyen et faire l’objet d’un débat public éclairé, ce qui aurait le double mérite de lutter contre la défiance à l’égard de la science et de ne plus abandonner notre avenir aux mains des oligarques de la Silicon Valley. Placer le monde du travail au centre permet de positionner la science non comme un enjeu de compétition internationale dans un contexte de dégradation géopolitique, mais bien dans la perspective d’une science ouverte où la coopération permet d’atteindre des résultats qui bénéficient au plus grand nombre.« Les chercheurs et personnels associés doivent participer pleinement aux orientations de leur domaine d’activité et avoir les moyens de peser sur les choix stratégiques sur leur lieu de travail. »Placer le bien commun au centre des enjeux de recherche permet aussi de réhabiliter la place de la recherche publique et de sortir du dogme libéral consistant à gaver de subventions le privé sans rien exiger en retour. Le second enjeu est budgétaire. Il est urgent d’atteindre les 3 % du Pib, ce qui suppose une réelle politique publique qui ne se contente pas de déclarations ronflantes. Là où on consacre une loi de programmation militaire à 413 milliards d’euros, on ne saurait consacrer 15 à 20 milliards par an à la recherche ? Les financements doivent mettre la recherche publique au centre du dispositif, être revalorisés puis sanctuarisés pour les inscrire dans une perspective de long terme, qui restaure l’attractivité abîmée d’un secteur en grande souffrance, en incluant des investissements pour les équipements et les bâtiments. Il faut revaloriser le statut d’enseignant-chercheur et toutes les grilles de la filière pour les mettre au moins au niveau, et réduire la précarité pour les contractuels et vacataires. C’est la condition d’une véritable ambition. (1) « L’État de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en France », juin 2024. Pour en savoir plus