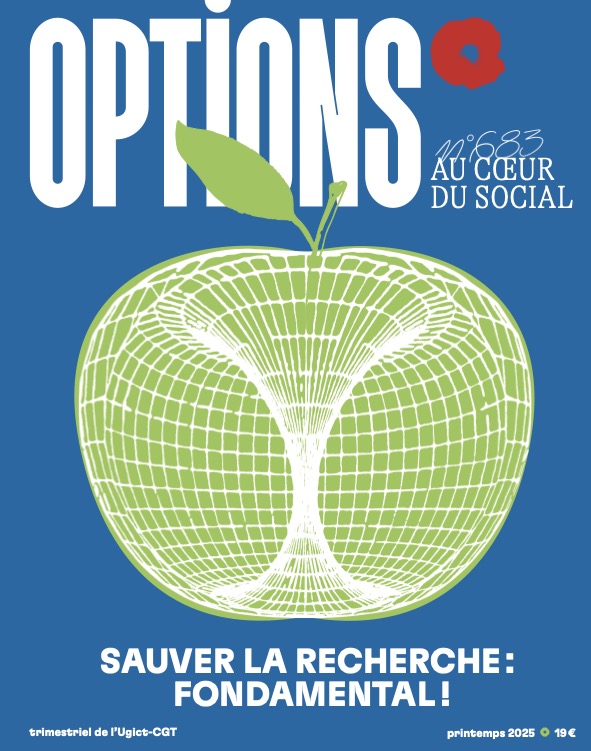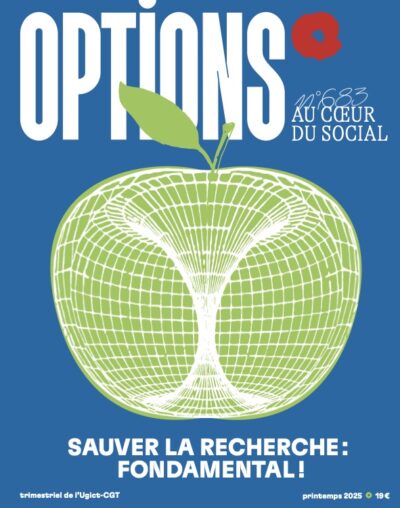« On revit le scandale de l’amiante. Des directions conscientes depuis longtemps de la dangerosité du produit, des actionnaires préférant capter les dividendes plutôt que chercher des solutions de substitution. Qu’ont retenu les industriels et les gouvernements du scandale de l’amiante ? Rien. » Ce 18 décembre 2024, Jean-Louis Peyren, secrétaire de la Fédération nationale des industries chimiques (Fnic-Cgt) intervient à la bourse du travail de Lyon à l’occasion d’une série de conférences sur les per et polyfluoroalkylées (Pfas), devant une centaine de militants de diverses branches venus de toute la France. La veille, aux côtés d’autres syndicalistes, il annonçait devant la presse la création d’un collectif Cgt sur le sujet. Première mission : informer.
Que sont les Pfas ? Utilisées à l’origine pour rendre les poêles anti-adhésives, ces milliers de molécules très pratiques car hydrophobes, oléofuges et résistantes aux hautes températures ont envahi notre univers. Pratiques, mais dangereuses pour la santé et l’environnement. Et presque indestructibles, s’accumulant dans les sols, dans les nappes phréatiques ou dans les organismes, au point d’avoir été surnommées « polluants éternels ».
Une dangerosité connue depuis les années 1970
Les industriels sont parfaitement au courant de leur dangerosité depuis les années 1970 (1), mais le scandale n’éclatera qu’au début des années 2000 aux États-Unis, quand l’avocat Robert Bilott se penchera sur le déversement dans l’environnement, par le groupe DuPont, de milliers de tonnes de boues contenant des Pfoa (acide perfluorooctanoïque, un type de Pfas) (2). La question enfle alors outre-Atlantique ; il faudra encore plusieurs années pour que certains types de Pfas (les Pfoa, les Pfos et les Pfhxs) soient interdits ou restreints au niveau international, via leur ajout à la convention de Stockholm.
La question n’émerge en Europe qu’au début des années 2020. En 2023, les autorités de plusieurs pays proposent une restriction globale de tous les Pfas dans l’Union européenne, un projet toujours à l’étude dans les bureaux de l’Agence européenne des produits chimiques (European Chemicals Agency, Echa) (3). En France, c’est dans cette période récente qu’ont été révélées les pollutions autour des usines Arkema et Daikin, qui fabriquent des Pfas à Pierre-Bénite (Rhône), ou celles d’usines utilisatrices, comme Tefal à Rumilly (Haute-Savoie).
Une mise en mouvement des structures de la Cgt
« J’ai compris que cette affaire allait avoir des conséquences et qu’il fallait faire quelque-chose au niveau syndical », explique la secrétaire régionale de la Cgt Auvergne-Rhône-Alpes, Agnès Naton. Un premier groupe informel est alors créé, qui s’élargit avec l’arrivée des fédérations de la Métallurgie et de la Chimie. « Nous allons aussi travailler avec des experts, et peut-être avec des associations écologistes, pour croiser les informations », précise Agnès Naton. « On a besoin de se fédérer pour instaurer un vrai rapport de force », explique Jean-Louis Peyren.
Outre les usines Arkema et Daikin, le projet de restriction européen identifie trois sites français : Chemours à Villers-Saint-Paul (Oise), Syensqo (ex-Solvay) à Tavaux (Jura) et Solvay à Salindres (Gard). Lorsque l’association écologiste Générations futures analyse la qualité de l’eau à proximité de cette dernière usine, elle découvre une pollution alarmante et porte plainte (4). Sophian Hanous, militant Cgt, représentant du personnel au sein de l’usine et membre du collectif Pfas, a alors contacté Générations futures, ce qui n’était pas évident car « certains camarades considèrent les associations écologistes comme des ennemies. » Pourtant, avant même les riverains, ce sont les travailleuses et travailleurs qui sont les plus exposés aux Pfas.
Faire reconnaître d’éventuelles maladies professionnelles
L’usine de Salindres produit notamment de l’acide trifluoroacétique (Tfa), un Pfas à chaîne courte utilisé pour la production de pesticides et dans l’industrie pharmaceutique. Comme tous les Pfas, il est persistant. Mais, plus récent que ses cousins les polymères à chaînes longues, sa toxicité a été moins explorée. Rien, toutefois, ne laisse présager de bonnes nouvelles pour les salariés et les riverains : l’Allemagne a par exemple demandé à l’Echa de le classer comme toxique pour la reproduction humaine. Inquiet, le Cse de l’usine de Salindres a commandé une expertise « risque grave ». Rendue en septembre 2024, elle note que « les représentations du risque chimique présentes sur le site minorent et banalisent les risques chimiques et leurs dangers ».
En Cse, les représentants du personnel ont réclamé un « bio monitoring » – qui leur était jusqu’alors refusé – pour évaluer l’exposition des salariés. « Notre collectif aura un rôle à jouer pour collecter des informations sur la santé, et travailler sur la reconnaissance d’éventuelles maladies professionnelles », anticipe Agnès Naton. Mais finalement, en septembre 2024, Solvay a annoncé la fermeture de l’usine. « C’est la triple peine. Nous avons pollué l’environnement. Nous avons été intoxiqués. Et maintenant, nous sommes virés », s’insurge Sophian Hanous.
La stratégie de retardement des industriels
Après la production des Pfas vient leur utilisation. Pour fabriquer des poêles anti-adhésives, l’usine Tefal de Rumilly a longtemps utilisé des Pfoa, et se sert aujourd’hui de polytétrafluoroéthylène (Ptfe), une molécule incluse dans le projet de restriction européen – et qui devrait donc être prochainement interdite. La stratégie du groupe Seb, dont Tefal est une filiale, consiste pour le moment à freiner la réglementation pour continuer à utiliser sa molécule le plus longtemps possible. Au sein de la Cookware Sustainability Alliance, le groupe a ainsi attaqué en justice, début janvier 2025, l’État du Minnesota qui a interdit le matériel culinaire contenant des Pfas.
L’année dernière en France, alors qu’une proposition de loi anticipait la restriction européenne en interdisant les Pfas dans certains produits comme le fart à ski, les textiles ou les cosmétiques (5), Seb a fait pression pour que soit retirés du texte les ustensiles de cuisine, allant jusqu’à mobiliser des salariés, dont certains sous étiquette Cfdt, Cfe-Cgc et Fo. La Cgt a refusé de participer à cette opération, non sans conséquence : « Les autres syndicats et les salariés nous reprochent de vouloir faire fermer l’usine. Mais ce n’est pas le sujet ! Le sujet, c’est de protéger les salariés, les riverains et les consommateurs, en réorientant la production. D’autant que dans notre domaine, il y a des alternatives », commente Ouria Belaziz, déléguée syndicale centrale Cgt chez Seb, et membre du collectif Pfas. « Il existe des preuves suffisamment solides que des alternatives techniquement et économiquement réalisables sont disponibles sur le marché. Notamment des revêtements “céramiques”, de l’aluminium anodisé et de l’acier inoxydable », comme le confirme le projet de restriction.
En Auvergne-Rhône-Alpes, 600 entreprises sous surveillance
Souvent citées, les casseroles sont pourtant loin d’être les seules concernées. « La plupart des salariés et des syndicats n’ont pas encore pris conscience que les Pfas pouvaient aussi les percuter. Le travail d’information est énorme. Rien qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) a mis 600 entreprises sous surveillance », pointe Agnès Naton. En effet, un arrêté de juin 2023 impose de surveiller les Pfas dans les rejets aqueux d’industriels potentiellement émetteurs. Et la publication des résultats a jeté un pavé dans la mare.
« On vient de découvrir que nous étions fortement concernés », réagit ainsi Nadia Sahli, déléguée syndicale centrale adjointe Cgt chez STMicro et salariée de l’usine de Crolles (Isère). Selon les chiffres fournis par la Dreal Auvergne-Rhône-Alpes, le site serait l’un des plus gros émetteurs de la région. Même constat en Centre-Val de Loire : le site de Tours est l’un des plus polluants de la région. Engagée depuis plus d’un an dans la démarche du Radar travail et environnement de l’Ugict-Cgt, Nadia Sahli compte capitaliser sur l’expérience acquise. « On pensait que les questions environnementales étaient la chasse gardée de la direction. Mais on se met à poser des questions en Cse et ils sont obligés de se réajuster. Auparavant, on avait pas conscience qu’on pouvait agir sur les modes de production, et finalement, sur les stratégies industrielles. »
Des pistes de substitution
D’autres entreprises sont-elles concernées ? En prenant en compte les émissions globales – et pas seulement aqueuses –, la restriction européenne identifie que le secteur du textile, des tissus d’ameublement, du cuir, des vêtements et des tapis est le plus émissif. Il est suivi par les gaz fluorés, les appareils médicaux et les produits de construction. Pour chaque secteur, le projet identifie les usages concernés, assortis de pistes de substitution.
De son côté, l’association Chemsec propose des outils de substitution en ligne. Un de ses responsables, Jonatan Kleimark, regrette que les entreprises ne se soient pas montrées plus actives ces dernières années : « Les problèmes liés aux Pfas sont connus depuis longtemps, et les premières mesures législatives sont arrivées il y a quatre ou cinq ans. Les entreprises ont eu tout le temps d’explorer différentes possibilités en matière de réaménagement ou de modification de la production. » Peut-être ont-elles besoin d’être davantage poussées par leur salariés, qui sont les premiers intéressés à une sortie de ces produits dangereux.
- Gaber Nadia, Bero Lisa, Woodruff Tracey. J., « The Devil they Knew: Chemical Documents Analysis of Industry Influence on Pfas Science », Annals of Global Health, juin 2023.
- Son histoire a été racontée dans le film de Todd Haynes, Dark Waters, en 2019.
- Ce projet de restriction, et en particulier sa partie principale (soit le rapport annexe XV) est accessible sur le site de l’Echa.
- Générations futures, « Pfas : Contamination des eaux par des “polluants éternels” à Salindres », rapport de février 2024.
- Victime collatérale de la dissolution de l’Assemblée nationale, la proposition de loi pourrait revenir en février 2025 dans le cadre de la niche parlementaire des écologistes.