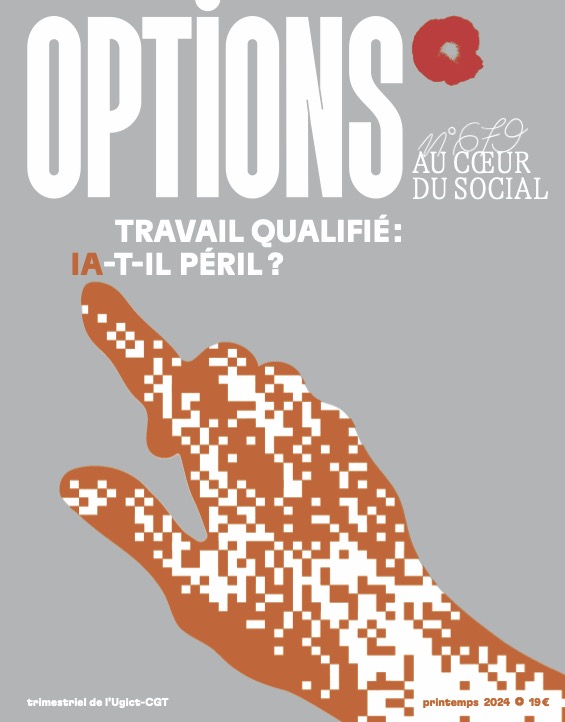L'Éditorial
À qui faire confiance ?
Et aussi
Platines
Platines – Bach, une “Passion” au goût d’inachevé
Dessin
Babouse – IA et impact sur l’emploi : l’Oit se veut rassurante, avec une méthode surprenante
Échecs
Solution des échecs – avril 2024
Échecs
Et aussi
Échecs – Adoubés et abusés
Livres
Romans
Romans – Au revers enfiévré de la ruralité
Livres
Polars
Polars – Les héros ne sont pas fatigués
Chroniques
Droit public
La protection fonctionnelle des agents publics
Culture
Visite tardive dans l’appartement-musée de Léonce Rosenberg
Sorties
Johann Le Guillerm invente à vue à Antony et à Châtenay-Malabry
Sorties
Quand l’archéologie entre en Seine
Sorties
L’agenda culturel d’avril 2024
Infographie
La smicardisation de la France tire les salaires vers le bas